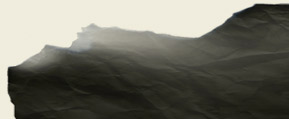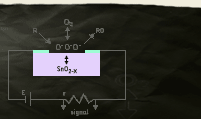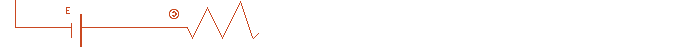Une exposition sur la guerre dans l’enceinte du musée de la Croix Rouge. A quoi doit-on s’attendre ?
Exposition éducative sur les atrocités de la guerre - promotion en images de l’action du CICR dans les zones de conflit - opération de légitimation par l’image de faits trop actuels pour bénéficier d’une quelconque résonance historique...
Ce type d’évènement engendre son lot de stéréotypes.
Si j’étais déjà allé au CICR pour d’autres raisons (des études de droit international), je n’avais jamais passé la porte de son musée.
L’antre de la guerre
Le bâtiment est beau, ses formes contemporaines. On y pénètre sans trop savoir à quoi s’attendre.
A l’intérieur, esthétique sobre, épurée, presque austère (sommes-nous passés du white cube au grey cube?) : une sorte de mausolée silencieux. Puis, un pôle interactif, une librairie et un café ; alors, deux possibilités : au sous-sol, le fond permanent - dirions nous dans un musée traditionnel, et celui-ci en a l’esthétique. Là on parle de la guerre, des hommes, de la Croix Rouge. De quoi montrer aux enfants venus des quatre coins du monde la réalité de la guerre. Une mise en scène salutaire de l’atrocité, érigée ici en patrimoine commun de l’Humanité. Au rez-de-chaussée, l’exposition que nous venons visiter, temporaire:WAR.
A quelques mètres de l’entrée, on s’interroge encore. Si l’on tient compte du lieu, de son poids historique, politique et intellectuel, des affiches géantes rencontrées dans les rue de Genève, du sujet, la seule chose qui vient à l’esprit est : on va me montrer ce qu’est la guerre ! Pas celle des grand-messes télévisées de l’internationale communicationnelle. Non, seulement ce que c’est que la guerre, froide, atroce sûrement (puisqu’on sait qu’elle l’est), néfaste, peu recommandable, combattable...
Là on craint déjà une autre opération de mise en scène ; celle qui viserait à nous assurer qu’elle est réellement atroce et tragique, mettant tout en œuvre pour nous écœurer. Mais rien de tout cela. Ou plutôt bien sûr, un peu de tout cela, mais autre chose aussi.
En effet, une fois l’imposante porte franchie, les nuées d’écoliers et de collégiens soigneusement évitées, le restaurant longé, on pénètre dans WAR. Déjà, la taille surprend. La dimension de l’espace qui lui est consacré est à mille lieues de celui des affiches géantes que l’on trouve dans la ville. Pas de grand spectacle donc ?
Une phrase de Suzanne Sontang sur la paix, une chronologie. Courte, elle aussi, car il s’agit simplement de contextualiser des images prises entre 2001 et 2003.
L’espace est assez unitaire. Pas d’enfilade de salles, mais une sorte d’étoile dont le centre, vide, nous invite à parcourir les rayons. Pas de hiérarchie entre les images, donc. Elles occupent toutes les lieux de la même façon, sans pour autant tomber dans le piège de la monotonie. On peut aisément les voir, les revoir, sans avoir à trop se déplacer. On se sent bien accueilli.
Pas de saturation dans cette courte visite. On sent même rapidement monter le désir de passer du temps devant chaque image, de voir, de revoir.
Devant nous seulement des photographies prises par des photojournalistes de l’agence VII sur le terrain des conflits nés du 11 septembre - World Trade Center en ruine, Afghanistan puis Irak : 52 clichés pour raconter “l’aventure guerrière qui a débuté à New York en septembre 2001”1 . Pas d’artistes donc, mais une véritable muséographie. L’entreprise n’est pas singulière, notamment en matière de photographie. Les frontières s’amenuisent de plus en plus, les passages entre les disciplines se faisant plus fréquents que jamais : développement pléthorique des expositions et manifestations autour du festival Visa pour l’image de Perpignan, artistes ou journalistes brouillant délibérément les pistes (la médiatisation dont bénéficie Luc Delahaye dans le monde de l’art contemporain est un des exemples les plus révélatuers de cet état de fait), etc. Rien de déstabilisant donc dans le parti pris de montrer de façon muséale des images de journalistes. Il semble que le débat engagé par le choix de l’exposition ne soit pas là.
Intimité VS. spectacle : au croisement des h(H)istoires
Derrière le spectacle des atrocités, c’est le particulier, l’intime qui s’installe et surprend le regardeur. La construction de l’espace - fragmenté - en pose les bases. Puis la mise en scène des images : des petits groupes auxquels s’ajoutent quelques mots de l’auteur. A chaque fois il s’agit pour le photographe d’exposer brièvement son attitude : pourquoi prendre de telles photos, pourquoi à ce moment-là, à cet endroit-là ? (on ressent l’importance d’un tel dispositif à chaque fois qu’un enfant demande au médiateur du lieu pourquoi le photographe prend en photo l’homme qui se fait tuer, pourquoi il n’intervient pas, et finalement pourquoi on l’expose).
Derrière l’Histoire qui défile, on entrevoit celle - plus particulière - des hommes qui en font part. Alors on passe aisément de l’Histoire aux histoires, celles des sujets qui font les images ; et c’est sûrement la force de cette exposition. Ce sont les sujets qui font l’image. Les marins qui se font baptiser dans le désert, les morts irakiens, les scènes de violence à l’égard des populations locales...
Tout est précis, particulier, intime. Pourtant, répétées, mises bout à bout, ces scènes, ces histoires particulières constituent l’Histoire qui s’écrit là bas. Et c’est bien la force de cette exposition que de montrer comment ce sont les histoires qui font l’Histoire. C’est aussi un bon moyen de permettre au sujet d’exister à nouveau. L’homme est trop souvent nié par une Histoire totalitaire que véhiculent les grands médias. Là, sur les cimaises, semble se redessiner une histoire des hommes.
La beauté malgrè tout
Seule une donnée vient finalement perturber le regard : la beauté des images, leur photogénie. Car si les faits sont violents, souvent atroces, les images sont belles, séduisantes même.
On peut se demander si de telles images dramatiques doivent être belles, ce à quoi Samuel Schellemberg répond “que les représentations des drames - au même titre qu’une oeuvre comme Le Radeau de la Méduse (1819) de Géricault - peuvent être belles”. “Regardez la photo de Bagdad sous un ciel noir à forte odeur de brûlé : la composition est exemplaire, l’équilibre entre le bas et le haut est parfait. En plissant les yeux, on dirait une peinture de Rothko. Le cliché n’en raconte pas moins la terrible réalité de cette ville meurtrie”.
Bien sûr il n’est pas question ici de reprocher à une image qui montre l’atrocité de la guerre d’être belle - quoique cette question mériterait des développement plus longs que la simple comparaison aux compositions picturales de Géricault.
Cependant leur choix et leur présentation doivent nous amener à nous interroger sur le dispositif mis en oeuvre. Nous ne sommes pas en présence d’un magazine auquel on accordera peut-être de s’attarder sur la photogénie - la médiagénie dit-on déjà - de certaines photographies. Nous sommes face à des images de photojournalistes montrées à un public dans un dispositif muséal.
Or - et il paraît certain que ce n’était pas le but de l’institution que de se focaliser sur celà (du moins nous l’espérons) - les considérations esthétiques semblent prendre le dessus sur une réalité qui paraît finalement n’être qu’évoquée. Beauté du dispositif de monstration, beauté des images...
On en vient finalement à se demander si des images moins belles auraient étaient choisies pour être exposées, si les photojournalistes n’arrivent à pénétrer le monde des musées qu’en injectant du beau, du composé dans leurs images. Ou dans un autre sens si linstitution muséale n’accepte pas d’eux seulement de belles images, des images construites comme des tableau, ce qui reviendrait à nier une grande partie de l’évolution du medium photographique.
S_ |